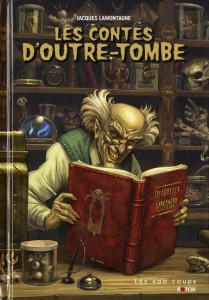Klovn un film danois du réalisateur Mikkel Nørgaard est la suite d’une populaire émission de télévision au caractère humoristique qui a remporté un grand succès auprès du public et qui fut diffusée le temps de 6 saisons au Danemark.
La bonne nouvelle c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir vu la télésérie pour vous initier à l’univers de Frank Hvam et Casper Christensen, les deux protagonistes principaux de l’histoire autour desquels se générera une multitude de situations aussi hilarantes que malfaisantes.
Frank vient de découvrir que sa conjointe est enceinte, un évènement qui viendra chambouler la vie de cet «adulescent» qui parvient à peine à s’occuper de lui-même. Pour prouver à sa copine qu’il a l’étoffe d’un bon père, il amènera lors d’une excursion de canot Bo, un jeune garçon de 13 ans dont le couple à la garde durant quelque temps. Cette situation ne fera pas du tout plaisir à son ami Casper qui utilise chaque année ce voyage comme prétexte afin de s’éloigner de sa femme et pour littéralement coucher avec tout ce qui bouge.
La comédie est citée par moment comme un sous-genre auquel il ne faut pas porter un grand intérêt. Comme si rire ne pouvait pas être justifiable le temps d’un film. Il faut dire que le genre a souvent surutilisé les mêmes recettes et qu’il est difficile de dénicher une comédie qui ose se lancer dans de nouveaux sentiers. Ce n’est heureusement pas le cas de Klovn qui sait surprendre en allant s’abreuver dans un type d’humour excessivement mordant et cynique que l’on voit que rarement ici et qui ferait certainement un tollé.
Aucune thématique n’est tabou, que ce soit l’homosexualité refoulée de Casper aux blagues dirigées vers le pénis du jeune Bo, tout est permis. Sans toutefois tomber dans la grossièreté et la gratuité, l’oeuvre traite surtout de sexualité et de perversions diverses en nous projetant dans des situations impossibles pour lesquelles Frank et Casper sont passés maîtres dans l’art d’empirer. L’une des plus marquantes est sans aucun doute celle où Frank, voulant bien agir, offre un « collier de perles » à sa femme endormie et emmitouflée dans les couvertures. Celle-ci se révèle à être sa belle-mère, atteinte à l’oeil par le sperme de son gendre, elle devra porter un cache-oeil pour le reste du film. Nous sommes loin de la comédie québécoise gentille. On se doute bien qu’un humour particulièrement danois vient imprégner l’oeuvre qui traite par moment et sans retenue des sujets comme la pédophilie.
Klovn demeure un film qui ne fait pas dans l’humour de bas étage. Il ne faudrait pas croire en lisant ce compte rendu qu’il s’équivaille aux comédies hollywoodiennes où la simple mention de la sexualité ou celle d’un organe génital a pour but de déclencher le rire. Si le scénario peut-être démesuré et extrêmement comique, ces scènes sont entre coupées de longues séquences où c’est davantage le côté humain de personnages et le malaise qu’ils dégagent qui sont mis de l’avant. En effet, récit est sinon plutôt «calme» et tombe qu’à de très rares reprises dans l’humour outrageux ce qui rend encore plus les scènes comiques est efficaces, puisqu’elles viennent nous prendre totalement par surprise. Cette dimension est enchéri lorsque l’on nous présente sans crier gare des parties de l’homme dans sa nudité la plus complète.
Malgré leurs faiblesses et leur comportement discutable, on demeure attaché aux personnages. Le lien qui se développe entre Frank et Bo est crédible et peut même s’avérer à être touchant.
L’esthétique de l’oeuvre qui n’est pas sans rappeler les téléséries américaines The Office ou Curb Your Enthusiasm était le choix visuel parfait pour nous raconter cette histoire de déchéance profondément humaine. Une comédie qui vous hantera plusieurs heures après votre visionnement… peut-on vraiment dire ça souvent?
– Benoit Mercier












 Bullhead est certainement l’un des films les plus bouleversants que j’ai eu la chance de voir cette année au festival Fantasia. Réalisé par le metteur en scène belge Michaël R. Roskam, ce long-métrage d’une puissance étonnante saura venir vous soutirer quelques larmes. Pour ma part, il est parvenu à obtenir la première position de mon palmarès personnel.
Bullhead est certainement l’un des films les plus bouleversants que j’ai eu la chance de voir cette année au festival Fantasia. Réalisé par le metteur en scène belge Michaël R. Roskam, ce long-métrage d’une puissance étonnante saura venir vous soutirer quelques larmes. Pour ma part, il est parvenu à obtenir la première position de mon palmarès personnel.













 Les amateurs de sensations fortes en ont eu pour leur argent hier soir lors de la projection de A Lonely Place To Die, un film du réalisateur britannique Julian Gilbey qui était sur place afin de présenter son long-métrage en première Canadienne. Pour ceux qui n’ont malheureusement pas eu la chance d’assister à la projection, imaginez le film Cliffhanger de Renny Harlin avec des personnages pour lesquels vous avez un véritable attachement, rajoutez s’y des scènes d’actions prenantes dans un paysage majestueux et vous vous rapprocherez de ce à quoi consiste ce Thriller à couper le souffle.
Les amateurs de sensations fortes en ont eu pour leur argent hier soir lors de la projection de A Lonely Place To Die, un film du réalisateur britannique Julian Gilbey qui était sur place afin de présenter son long-métrage en première Canadienne. Pour ceux qui n’ont malheureusement pas eu la chance d’assister à la projection, imaginez le film Cliffhanger de Renny Harlin avec des personnages pour lesquels vous avez un véritable attachement, rajoutez s’y des scènes d’actions prenantes dans un paysage majestueux et vous vous rapprocherez de ce à quoi consiste ce Thriller à couper le souffle.